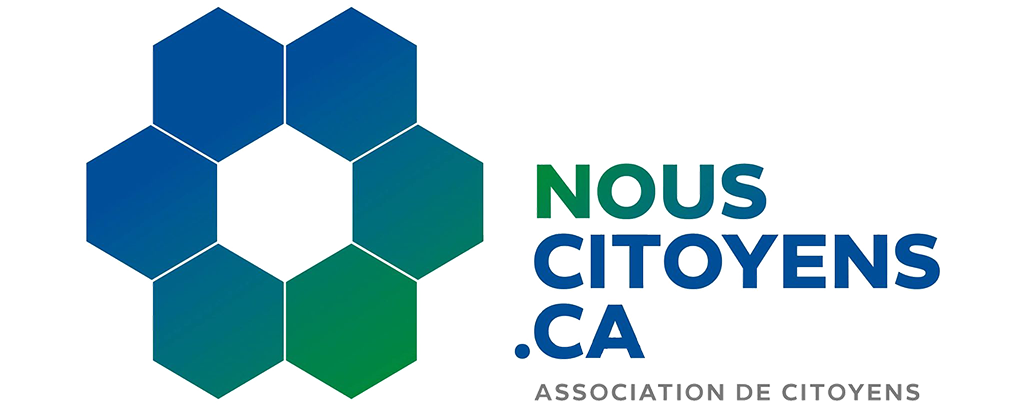12 SEPTEMBRE 2022
Alors que l’usage des pesticides et des antibiotiques dans l’agriculture et l’élevage fait des ravages, la santé par les plantes – ou phytothérapie – suscite de nos jours un certain engouement, au-delà des cercles d’initiés et des agriculteurs biologiques. Or, le gouvernement continue de bloquer leurs alternatives naturelles et la transmission de ces savoirs. Pourquoi prendre soin des cultures et soigner les animaux avec des plantes reste-t-il aujourd’hui illégal ? Voyage en Absurdie.
* * *
JAI ARRÊTÉ les pesticides de synthèse en 1993 grâce à des préparations à base de plantes. » Jean-François Lyphout, horticulteur pendant une trentaine d’années en Dordogne, s’est reconverti dans la production de traitements naturels et dans la formation.
En 2006, la loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt rend illégales ces préparations, telles que le purin d’ortie ou l’infusion d’ail. Désormais, elles sont soumises aux mêmes procédures d’évaluation que des pesticides de synthèse, c’est-à-dire une autorisation de mise sur le marché ou une homologation. Au vu du prix et de la lourdeur des dossiers, très peu de substances à base de plantes sont évaluées. Tout ce qui n’est pas autorisé devient interdit.
« Avant que la France publie cette loi, ces pratiques ne posaient problème nulle part en Europe. C’est le ministère de l’Agriculture français qui l’a quasiment imposé », dénonce Jean-François Lyphout, également président de l’association Aspro-PNPP, qui milite depuis 2009 pour reconnaître les alternatives naturelles aux pesticides. « On navigue dans l’absurde. Pourquoi des produits toxiques et dangereux sont autorisés sans problème et nos produits naturels faits à la ferme sont interdits ? ».
ON NAVIGUE DANS L’ABSURDE. POURQUOI DES PRODUITS TOXIQUES ET DANGEREUX SONT AUTORISÉS SANS PROBLÈME ET NOS PRODUITS NATURELS FAITS À LA FERME SONT INTERDITS ?
Après des années de combat, la loi ÉGalim a autorisé en 2018 l’usage de plantes alimentaires comme « biostimulants », c’est-à-dire pour stimuler la plante et non pas pour la soigner. Si cette loi constitue une première étape, ces modalités d’application[1] ne sont toujours pas satisfaisantes pour les défenseurs des préparations naturelles.
Elles continuent d’exclure de nombreuses plantes, comme la fougère utilisée pour repousser les vers des pommes de terre, par exemple. « Si un maraîcher produit des patates avec de la fougère, il n’a plus le droit de les vendre », illustre Jean-François Lyphout.

Alors que le gouvernement publie des plans pour réduire le recours aux antibiotiques dans l’élevage et aux pesticides dans l’agriculture, il continue de bloquer leurs alternatives naturelles. Publié en 2008, le plan Écophyto avait pour objectif de réduire de 50 % l’usage des pesticides d’ici 2018.
Le constat d’échec est clair : l’usage des pesticides a augmenté de 25 % en dix ans[2]. « On dit aux agriculteurs qu’il n’y a pas d’alternative. On oublie de préciser ‘légale’ », fait savoir André Ledu, éleveur breton à la retraite.
La situation est similaire dans l’élevage. « Quand mon animal a une conjonctive et que je lui applique du miel pour la cicatriser, je ne fais que des choses illégales », illustre André Ledu, également membre du collectif « Plantes en élevage », qui lutte pour faire reconnaître ces pratiques. Soigner avec des produits naturels demande une prescription vétérinaire et une autorisation de mise sur le marché.
DES ARGUMENTS TECHNIQUES
QUI CACHENT DES CHOIX POLITIQUES
« Dès lors que l’on n’a pas démontré qu’il n’y a pas de risque, on part du principe que ce n’est pas autorisé », explique Jean-Pierre Orand, directeur de l’Agence nationale du médicament vétérinaire. Il précise : « Toutes les plantes ne sont pas anodines. Certaines huiles essentielles peuvent provoquer un cancer, un avortement ou agir sur le système nerveux central. »
De nombreuses huiles essentielles sont pointées du doigt, comme l’origan ou le basilic, car elles contiennent des molécules accusées d’être toxiques ou cancérigènes, comme le carvacrol ou l’estragole, par exemple. Ces effets sont observés à des doses très élevées et sur une molécule isolée. Une étude montre que, dans l’extrait de basilic, d’autres molécules présentes limitent toutefois ces potentiels effets indésirables[3].
LA PLUPART DES PRODUITS ANIMAUX DEVRAIENT ÊTRE JETÉS. SI PERSONNE N’APPLIQUE LA RÉGLEMENTATION, POURQUOI NE PAS LA CHANGER ?
Un animal, lorsqu’il pâture, consomme de nombreuses plantes, comme l’ortie, le pissenlit ou la lavande. Mais les éleveurs ne peuvent pas les donner à leur bétail car, comme la majorité des plantes et huiles essentielles, elles n’ont pas suivi les procédures d’évaluation destinées aux médicaments vétérinaires.
« L’usage traditionnel ou empirique d’une plante suppose généralement que les bénéfices sont supérieurs aux risques pour l’animal », souligne Yassine Mallem, enseignant-chercheur à l’école vétérinaire de Nantes.
Il existe une possibilité pour les vétérinaires de prescrire des plantes qui ne sont pas autorisées sur le marché en « dernier recours », lorsque les médicaments conventionnels n’ont pas marché. Pour pouvoir vendre leur produit, les éleveurs doivent alors respecter des délais contraignants, de 7 jours pour le lait et 28 jours pour la viande, qui sont doublés pour l’agriculture biologique.
« En appliquant la réglementation actuelle, un poulet qui n’a consommé aucun antibiotique mais que des huiles essentielles n’a pas le droit d’être vendu », regrette André Ledu, avant d’ajouter : « La plupart des produits animaux devraient être jetés. Si personne n’applique la réglementation, pourquoi ne pas la changer ? ».

L’Institut technique pour l’Agriculture biologique (ITAB) a proposé une catégorie de « préparations naturelles traditionnelles » pour autoriser le recours à 223 plantes peu préoccupantes à des fins thérapeutiques. Elles pourraient être utilisées par les éleveurs eux-mêmes, sans autorisation de mise sur le marché ni temps d’attente, à condition qu’ils soient formés.
En mars 2022, le gouvernement a publié une ordonnance[4] qui maintient la réglementation actuelle. Il faudra attendre la prochaine délibération de la Commission européenne, en 2027, pour espérer voir une évolution… qui ne sera pas appliquée avant 2030.
« La Direction générale de l’Alimentation (DGAL) aurait pu légaliser nos pratiques, mais elle refuse une discussion ouverte et franche, regrette André Ledu. Elle ne veut pas entendre parler d’autre chose que des médicaments vétérinaires. » Contactée par Sciences Critiques, la DGAL n’a pas souhaité nous répondre.
D’UN CÔTÉ, L’ADMINISTRATION APPLIQUE UNE MÊME LOGIQUE SANS RÉFLÉCHIR À L’ORIGINE DU PRODUIT. DE L’AUTRE, LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE UTILISE UNE ARGUMENTATION TECHNIQUE POUR DÉFENDRE DES ENJEUX DE POUVOIR ET JUSTIFIER DES ORIENTATIONS POLITIQUES.
« Tout produit ayant un effet thérapeutique doit suivre la même réglementation que les médicaments vétérinaires », regrette Michel Bouy, vétérinaire rural spécialisé en phytothérapie et chercheur à l’Institut mondial de recherche pour l’agriculture biologique (FiBL).
Il précise : « D’un côté, l’administration applique une même logique sans réfléchir à l’origine du produit. De l’autre, la profession vétérinaire utilise une argumentation technique pour défendre des enjeux de pouvoir et justifier des orientations politiques. »
La santé par les plantes a longtemps été peu considérée, se limitant aux éleveurs et agriculteurs biologiques. Depuis une dizaine d’années, la demande s’est beaucoup élargie. Jean-François Lyphout affirme vendre 80 % de ses préparations naturelles à des agriculteurs conventionnels.
Même de grosses coopératives et exploitations s’y sont mis, comme en témoigne dans cette vidéo Thierry, céréalier, propriétaire de 160 hectares de terres. Les motivations sont nombreuses : limiter le développement des bactéries résistances aux antibiotiques, réduire l’impact sur l’environnement ou faire face à des parasites de plus en plus résistants aux produits de synthèse.
DES SAVOIRS QUI NE SONT PAS TRANSMIS
« La profession vétérinaire a eu l’impression de se faire dépasser par les éleveurs qui en savaient plus qu’eux sur les plantes, considère Michel Bouy. Face à cela, elle a considéré que c’était trop dangereux de les laisser entre les mains des éleveurs et elle a fait pression. »
Le chercheur en phytothérapie en a été témoin. En 2018, l’inspection vétérinaire l’a convoqué à passer devant une chambre de discipline. Son délit ? Apprendre aux éleveurs à fabriquer leurs propres traitements. Seuls les vétérinaires sont autorisés à faire des préparations à base de plantes dites « magistrales« . « Ce qui compte, c’est que les éleveurs utilisent les plantes avec justesse », estime le praticien.
« Le problème ne vient pas des vétérinaires, mais de leur formation », considère André Ledu. Ils ne connaissent pas le fonctionnement des plantes. » « Nos connaissances en phytothérapie sont nulles, témoigne Joséphine Malafosse, étudiante à l’école vétérinaire de Nantes. J’en ai un avis peu favorable, mais c’est par ignorance. En quatre ans, je n’ai eu aucun enseignement là-dessus. »
Marine Weishaar n’a pas plus entendu parler de santé par les plantes pendant sa formation d’ingénieur à AgroParisTech. Même dans la spécialité sur la protection des plantes et l’environnement, elle n’a eu qu’une seule intervention sur les produits autorisés en agriculture biologique. « On n’ a pas de cours sur des méthodes autant alternatives, précise la jeune diplômée. Ça fait penser à du charlatanisme. »
LA RECHERCHE VÉTÉRINAIRE EST PRINCIPALEMENT FINANCÉE PAR LES LABORATOIRES PRIVÉS.
Les formations évoluent doucement. Depuis 2018, les écoles vétérinaires ont lancé un diplôme inter-écoles en phytothérapie, qui forme chaque année une trentaine de vétérinaires. « On a vu sur le terrain que des éleveurs avaient une envie de naturel. En face, ils avaient des vétérinaires qui n’étaient pas formés pour la demande », note Yassine Mallem, qui s’est formé à la phytothérapie en coordonnant ce diplôme.
Si ce diplôme est une première étape, la phytothérapie est toujours quasiment absente de la formation initiale. « L’enseignement a besoin de se nourrir de la recherche », souligne l’universitaire. Que montre la recherche sur la santé par les plantes ?

Il existe très peu d’études cliniques sur les traitements naturels car « la recherche vétérinaire est principalement financée par les laboratoires privés », constate Yassine Mallem. S’il n’y a pas d’intérêt de recherche et développement pour les laboratoires, il n’y a pas de financements[5].
La situation est un peu différente pour la santé végétale. Les pesticides de synthèse étant interdits les uns après les autres, l’État a commencé à soutenir la recherche sur l’effet des préparations naturelles sur les cultures. Il a financé l’ITAB pour qu’il réalise les demandes d’homologation auprès de la Commission européenne.
UNE PRODUCTION DE SAVOIRS
DANS LES LABORATOIRES… ET DANS LES CHAMPS
Une étude a testé l’effet du sucre sur une chenille, appelée la pyrale du maïs[6]. « Au début, la personne qui faisait les manipulations n’y croyait pas du tout, mais elle a observé des résultats concluants. Elle était estomaquée », se souvient Pascal Marchand, coordinateur du pôle intrant à l’ITAB. La plupart des plantes ne tuent pas les insectes qui s’attaquent aux cultures, mais les empêchent de pondre ou handicapent leur descendance.
« Ce n’est pas parce que ces produits sont moins toxiques qu’ils n’ont pas un effet insecticide, de manière indirecte », souligne Pascal Marchand. Les mêmes résultats sont observés en santé animale sur les parasites digestifs. « Les plantes vont perturber le cycle de reproduction parasite plutôt que de le tuer, explique Michel Bouy, chercheur au FiBL. Les animaux peuvent vivre avec et les contrôler, à condition de renforcer leur immunité. »
En 2006, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) perquisitionne le domicile du paysagiste Eric Petiot, co-auteur d’un livre sur le purin d’orties, un produit non homologué à l’époque, comme le relate cet article d’un site d’information spécialisé.

C’est ce qui a motivé Pascal Marchand, qui a vu ses deux oncles agriculteurs mourir d’un cancer de la peau, à rejoindre l’ITAB pour légaliser ces alternatives aux pesticides. Sa mission ? Coordonner des dossiers pour homologuer des substances de base pour qu’elles soient approuvées par la Commission européenne. Il réalise depuis l’intérieur l’absurdité du système.
Les procédures nécessaires à la réalisation de ces dossiers coûtent entre cinq et sept millions d’euros et peuvent durer jusqu’à douze ans pour autoriser des préparations telles que l’extrait de prêle ou du sucre. « J’ai passé des années à autoriser du sel de cuisine. Est-ce que tout ça était nécessaire ? », questionne Pascal Marchand. « La Commission fait pression sur les pétitionnaires pour retirer des dossiers, poursuit le chercheur, qui a lui-même retiré un dossier sur la valériane. On est arrivé à un système de guérilla pour faire passer ces produits. C’est du pur délire. »
NOUS N’AVONS PAS BESOIN DE PASSER PAR DES INSTITUTS TECHNIQUES POUR SAVOIR SI ÇA MARCHE OU PAS. IL N’Y A PAS QUE LES LABORATOIRES, NOS FERMES SONT AUSSI DES LIEUX D’EXPÉRIMENTATIONS. LES PAYSANS NE PEUVENT PAS TOUT SAVOIR, MAIS LES SCIENTIFIQUES NON PLUS.
« Nous n’avons pas besoin de passer par des instituts techniques pour savoir si ça marche ou pas, souligne Jean-François Lyphout. Il n’y a pas que les laboratoires, nos fermes sont aussi des lieux d’expérimentations. » Quand l’arboriculteur applique du jus de consoude sur ses rosiers, et qu’il voit deux jours plus tard qu’ils sont magnifiques et que le champignon, l’oïdium, a disparu, il produit aussi une forme de savoir.
« Je ne crois en rien mais j’ai des yeux, souligne Jean-François Lyphout, qui observe de meilleurs résultats avec certains produits naturels qu’avec des produits de synthèse. Les paysans ne peuvent pas tout savoir, mais les scientifiques non plus. »
Que ce soit comme alternative aux pesticides ou aux médicaments de synthèse, les principaux freins aux préparations naturelles traditionnelles sont les mêmes : à la fois les vétérinaires et ingénieurs agronomes ne sont pas formés à leurs usages, et l’administration, soumise aux poids des lobbys, impose des réglementations inadaptées conçues pour les produits de synthèse.
Via son plan France 2030, le gouvernement a fait le choix d’investir deux milliards d’euros dans l’agriculture, sur la robotique, la génétique et le numérique, en promettant de réduire l’usage des pesticides grâce à une agriculture connectée et aux innovations technologiques.
Et si nous commencions par reconnaître la diversité des formes de savoir et la pertinence des savoirs paysans avant de compter sur les drones et l’intelligence artificielle ?
Lola Keraron, journaliste / Sciences Critiques.
* * *
References
| ↑1 | – Voir l’arrêté du 14 juin 2021 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de préparations naturelles peu préoccupantes. |
|---|---|
| ↑2 | – D’après la note de suivi du plan Écophyto 2018-2019, publiée en janvier 2020. |
| ↑3 | – Voir cette étude sur les effets de l’extrait de basilic sur le foie de rat et de l’homme, publiée dans la revue Food and Chemical Toxicology en 2008. |
| ↑4 | – Le gouvernement a publié les dispositions d’adaptation au règlement européen le 23 mars 2022 par ordonnance. |
| ↑5 | – Lire notre enquête : Covid-19 : pourquoi les recherches sur les plantes médicinales sont bloquées, 24 mars 2022. |
| ↑6 | – Voir cette étude sur l’effet du sucre sur la pyrale du maïs, publiée en 2021 dans la revue Innovations Agronomiques. |