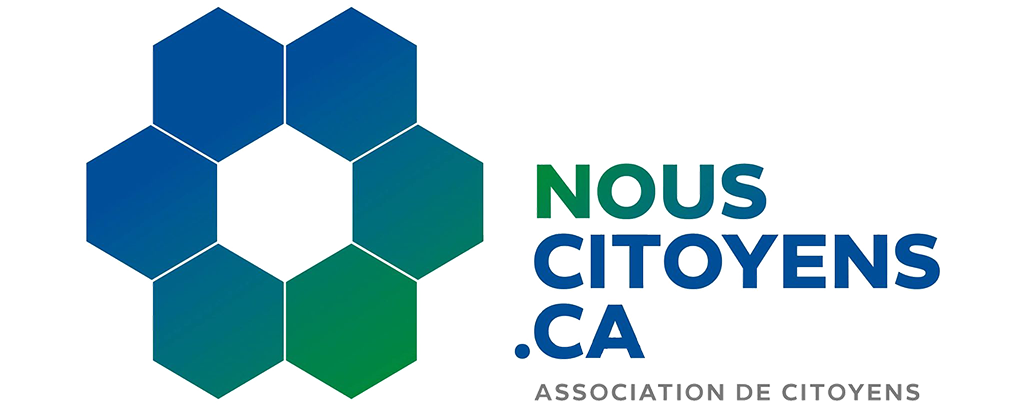Photo: Carlos Osorio Associated Press
Un adulte québécois sur cinq aurait eu des symptômes compatibles avec un trouble d’anxiété généralisée ou une dépression majeure au cours des deux semaines précédant une enquête de l’Université de Sherbrooke sur la santé mentale de la population en temps de pandémie.
Stéphane Baillargeon
Daphney Bradette le dit franchement : le retour au confinement, qui recommence mercredi soir à minuit, l’a frappée comme un coup de marteau.
« Les deux premières semaines du premier confinement ont été presque drôles, dit la Montréalaise de 23 ans. Après, c’est vite devenu difficile. Maintenant, on sait ce que c’est. Je ressens beaucoup de tristesse et j’ai peur de sombrer dans une dépression. »
Elle exerce la profession de designer d’intérieur depuis deux ans, à la maison au début de la pandémie, de retour au bureau depuis quelques semaines. « Le télétravail a été très, très difficile et je n’ai pas envie de le refaire, dit-elle. C’était juste du négatif et rien de positif. »
« J’ai l’impression que cette situation développe une sorte d’urgence de vivre. C’est comme si c’était la fin du monde et qu’il fallait tout faire maintenant. On ne sait pas combien de temps il nous reste. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, autant tout faire maintenant. »
Ce sentiment lui semble partagé par son entourage. Daphney Bradette le dit aussi franchement : ses proches ne vont pas mieux qu’elle.
« C’est très commun de ressentir de la peine. Hier [lundi], des amis m’ont écrit et ils étaient tous déprimés. Il n’y a plus rien. Tout le monde est au bord de pleurer. À quoi ressemble le futur pour notre génération ? Une vie sous une pandémie mondiale. Une vie sous les changements climatiques. Une vie sous d’énormes problèmes financiers. On est dans le noir. On est dans un trou sans espoir d’en sortir. »
Des résultats inquiétants
La crevasse, large et profonde, a englouti beaucoup de gens depuis quelques mois. Une enquête de l’Université de Sherbrooke diffusée mardi confirme l’ampleur de l’impact psychosocial de la pandémie sur la population québécoise. Un adulte sur cinq aurait eu des symptômes compatibles avec un trouble d’anxiété généralisée ou une dépression majeure au cours des deux semaines précédant le sondage Web administrés début septembre.
La situation se détériore encore plus en zone urbaine, avec un adulte sur quatre frappé. Trois groupes en particulier se démarquent dans cette portion sombre : les travailleurs de la santé, les anglophones et, surtout, les jeunes adultes. Dans ce dernier cas, un adulte sur trois de 18 à 24 ans (37 % du lot) rapporte des symptômes anxieux ou dépressifs.
Une vie sous une pandémie mondiale. Une vie sous les changements climatiques. Une vie sous d’énormes problèmes financiers. On est dans le noir. On est dans un trou sans espoir d’en sortir.
— Daphney Bradette
L’enquête s’inscrit dans une plus vaste démarche internationale (dans huit pays) et interdisciplinaire (santé, sciences politiques et communications) qui a permis dans un premier temps (fin mai-début juin) de montrer l’étendue mondiale « assez élevée » de l’anxiété et de la dépression, cependant plus manifeste aux États-Unis qu’au Canada ou au Québec. Un nouveau volet permettra éventuellement de reprendre cette comparaison mondiale. Pour l’instant, la présente enquête, uniquement québécoise, propose « un petit ajout », comme le résume la responsable du travail, la professeure Mélissa Généreux, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.
« Les données montraient que ça n’allait pas bien en juin et que ça n’allait toujours pas bien en septembre, ajoute-t-elle. On voit à quel point les choses évoluent vite. Il y a une différence entre comment on se sentait il y a deux semaines et comment on se sent aujourd’hui avec les annonces d’un nouveau confinement. Notre hypothèse assez sérieuse, c’est que la situation est appelée à se détériorer avec la mise en œuvre des nouvelles mesures d’isolement. »
Daphney Bradette en témoigne. La professeure Généreux cite le cas de ses propres étudiants dans son université, où la formation continue de se donner en présentiel. À 17 h 30 lundi, le cours a cessé pour permettre aux étudiants de regarder la conférence fatidique de François Legault annonçant le cadenassage du Québec.
« C’était déprimant de voir les visages des étudiants, dans la fourchette d’âge des 18-24 ans, de loin la plus affectée en ce moment. La pandémie chamboule l’univers de tout le monde, mais à cet âge, le recul est moins grand. Plus on est jeune, plus on est affecté, en moyenne, évidemment. Je pense que ça vient de la difficulté de donner un sens à tout ça et de se faire confiance pour passer à travers parce qu’on a déjà surmonté de graves problèmes. Je propose une analogie avec une peine d’amour. La première est souvent la plus difficile. »
La résilience
La Dre Généreux fait du « sentiment de cohérence » (ou plutôt de son absence, ou de sa faiblesse) le facteur de risque central pour sombrer psychologiquement. L’enquête le mesure en posant des questions liées à la capacité de comprendre les événements stressants, de leur donner un sens et de maîtriser ces situations. À peine 6,5 % des gens qui ont un sentiment de cohérence élevé affichent des symptômes de dépression par rapport à 26 % pour ceux qui ont un sentiment de cohérence plus faible.
L’hypothèse de départ de l’enquête établit aussi que les stratégies de communication en temps de pandémie influencent la réponse psychologique des populations. En gros, le traitement médiatique de la pandémie modulerait les perceptions de la crise et les résiliences individuelles.
Ce rapprochement pourrait expliquer pourquoi les Anglos québécois comme les plus jeunes angoissent et dépriment davantage. Les premiers s’alimentent aux réseaux américains, réputés plus alarmistes ; les seconds consultent les réseaux sociaux ou leur entourage plutôt que les sources médiatiques traditionnelles comme la bonne vieille télé.
L’importance d’une stratégie de communication adéquate saute aux yeux. « On parle beaucoup de la lutte contre le virus, du nombre de décès, etc. », dit la médecin, elle-même ancienne directrice de la santé publique en Estrie. Elle dirigeait le secteur au moment de la tragédie du train fou de Lac-Mégantic (juillet 2013, 47 morts), où elle a documenté des réactions angoissées semblables à celles vécues dans une situation de crise.
« Pour alimenter le sentiment de cohérence, il faut aussi donner des outils à la population. Les jeunes s’informent sur Internet. La stratégie de communication est-elle assez adaptée ? On peut poser la question. On peut poser une autre question pour les anglophones : les rejoint-on correctement ? La conférence de presse du premier ministre livre un discours cohérent, mais elle ne rejoint pas tout le monde de façon égale. »
Une stratégie plus éclatée et adaptée permettrait de régler certains problèmes, disons, en amont. Pour les gens souffrant de maux psychologiques, les services professionnels demeurent nécessaires. Daphney Bradette a d’ailleurs décidé de consulter un psychologue. Sa décision a été prise avant la conférence fatidique du premier ministre Legault lundi pour annoncer un nouveau grand enfermement collectif. « J’avais déjà entamé les démarches. Je vais me faire aider », résume-t-elle.
« Les services cliniques seuls ne suffisent pas, conclut la Dre Généreux. Il est utopique de penser que le milieu clinique va pouvoir traiter une personne sur trois, quatre ou cinq, en tenant pour acquis que tout le monde ira chercher de l’aide. Pour absorber une telle souffrance psychologique de la population, il va falloir utiliser la première ligne communautaire pour lire les signaux d’alarme, accompagner les personnes en souffrance et donner les premiers soins psychologiques. Il nous faut un filet de sécurité plus large pour recevoir de l’aide de la coiffeuse, des voisins, des amis, des enseignants… »
Sondage
L’enquête de l’Université de Sherbrooke s’appuie sur un sondage Web réalisé par la firme Léger auprès de 6261 adultes du 4 au 14 septembre 2020. Les Québécois interrogés ont été joints dans sept régions sociosanitaires du Québec : Mauricie-Centre du Québec, Estrie, Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie. Bref, tout le sud de la province, encore le plus touché par la nouvelle vague pandémique.
UN VACCIN PEU POPULAIRE
À peine deux adultes québécois sur trois seraient prêts à recevoir un vaccin homologué contre la COVID-19, selon les données de l’enquête récente de l’Université de Sherbrooke. Plus précisément, 16 % des répondants le refuseraient et 19 % hésiteraient à le recevoir. Cette proportion de refus a gonflé de quatre points depuis le début de l’été. Par comparaison, les antivaccins pour les doses administrées en petite enfance totalisent habituellement moins de 5 % de la population. « On est dans des intentions, mais c’est quand même inquiétant, commente la professeure Généreux, responsable de l’enquête. Refuser un vaccin homologué ? Il ne faudrait vraiment pas que cette tendance continue à la hausse. » La Dre Généreux note que les antivaccins souffrent aussi le plus d’anxiété et de dépression. « On parle beaucoup plus du virus que des effets collatéraux. Il est peut-être temps de recentrer le discours pour confronter les discours de méfiance et les croyances erronées. En s’attaquant à ces dérives, on ferait des gains sur le plan psychologique et dans le cadre de la lutte contre le virus. »