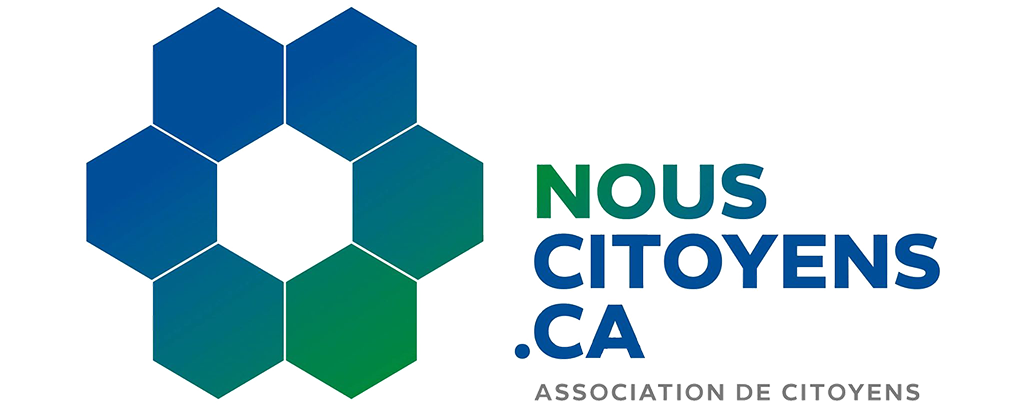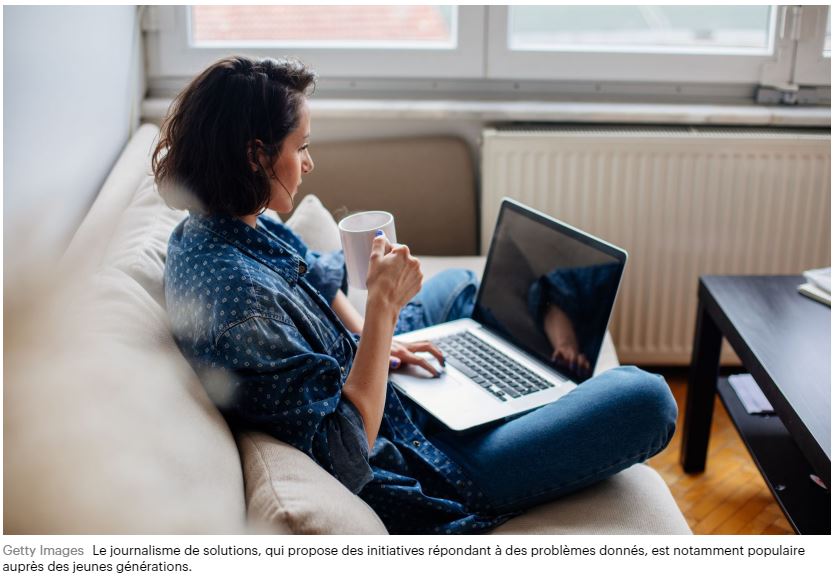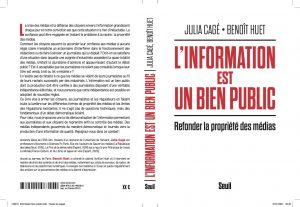Caroline Montpetit
Ils nous tendent chaque matin un miroir grossissant, au point que de plus en plus de citoyens ont pris le parti de les éviter, parfois suivant les recommandations de professionnels de la santé, pour préserver un restant de santé mentale en ces temps de crise. Déjà très affectés par la révolution technologique et par une crise de crédibilité, les médias d’information sont devenus, avec la pandémie, à la fois des services essentiels et des facteurs de déprime, charriant chaque jour leur lot de mauvaises nouvelles et de prévisions moroses, portant « la plume dans la plaie », comme le suggérait le célèbre journaliste français Albert Londres.
« Votre édition du matin donne envie de vider une boîte de pilules et de partir définitivement vers un autre monde », écrivait récemment au Devoir un lecteur découragé. Dans l’isolement généralisé provoqué par la pandémie, de plus en plus de membres du public réclament des médias une vision plus positive des choses, pour contrer le parti pris négatif qui les caractérise depuis longtemps. C’est notamment ce qui a donné lieu depuis quelque temps à une tendance que l’on a baptisé « le journalisme de solutions » ou, selon l’abréviation anglaise, le « sojo ».
Cette forme de journalisme, qui propose des initiatives répondant à des problèmes donnés, est notamment populaire auprès des jeunes générations, comme en témoigne une étude menée en 2015, en Grande-Bretagne, selon laquelle cette forme de journalisme était la préférée de 64 % des jeunes de 35 ans et moins.
Dans un contexte où tout va mal, « le réflexe accusateur des journalistes est ressorti », dit-elle. Elle relève notamment la nécessité de nuancer les comparaisons entre les bilans de décès par exemple, qui ne comptabilisent pas, dans certains pays, les morts survenues durant le week-end. « Il y a aussi un problème de rythme » pour les journalistes, « et de temporalité », dit-elle. « On ne peut pas revirer le système de santé en une minute », remarque-t-elle.
Tendance de fond
Parallèlement, le journalisme dit « de solutions » est une « tendance de fond », qui avait fait son apparition bien avant la crise du coronavirus, constate Colette Brin, professeure au Département d’information et de communication de l’Université Laval. Le Huffington Post avait, par exemple, lancé une section de journalisme de solutions dans son édition québécoise, ainsi que dans toutes ses autres éditions à travers le monde, relève Patrick White, professeur à l’École des médias de l’UQAM. Aujourd’hui, cette section du Huffington Post subsiste dans l’édition française et est intitulée « Ça marche ». Depuis le début de la pandémie, on peut y lire des articles relatant des histoires positives liées à la COVID-19, des récits d’amitiés nées du confinement, par exemple, ou rapportant l’invention d’un jeu vidéo par un enfant de neuf ans.
Mais le journalisme de solutions ne se limite pas aux histoires réjouissantes, relève Patrick White. « Il faut aller au-delà des histoires feel good », dit-il. Il s’agirait plutôt de faire du « journalisme à deux yeux », comme le nomme la journaliste et professeure Pauline Amiel, dans le livre Le journalisme de solutions, qui vient de paraître aux presses de l’Université de Grenoble. « Ne pas masquer les mauvaises nouvelles, mais redonner leur juste place aux informations enthousiastes, aux réussites, au développement de l’humanité », dit-elle.
Il reste que, les études le prouvent, l’être humain est naturellement attiré vers les nouvelles négatives, même si ce ne sont pas nécessairement celles qu’il recherche en premier lieu. Cela n’est pas sans raison que les faits divers sanglants sont joués en première page par certains médias.
Un effet déprimant
Dans un article publié en 2015 sur The Conversation, un média en ligne d’information et d’analyse de l’actualité indépendant, Denise Baden, professeure d’économie durable de l’Université de Southampton, relevait que les médias tiennent pour acquis que « les mauvaises nouvelles sont vendeuses », qu’elles accroissent la conscience sociale ainsi que les actions positives qui en découleraient.
Or, les études menées par l’équipe de Denise Baden tendent à prouver que les mauvaises nouvelles auraient plutôt l’effet contraire. « Plus les nouvelles rendent les gens anxieux, tristes, déprimés et inquiets, moins ils ont tendance à faire des dons, à agir de façon responsable envers l’environnement ou à faire connaître leur point de vue sur différents sujets », écrit-elle.
Plus les nouvelles rendent les gens anxieux, tristes, déprimés et inquiets, moins ils ont tendance à faire des dons, à agir de façon responsable envers l’environnement ou à faire connaître leur point de vue sur différents sujets
— Denise Baden
D’autre part, des études ont démontré que les nouvelles « typiques » avaient tendance à provoquer une chute d’humeur chez 38 % des femmes et chez 20 % des hommes. C’est sans doute ce qui explique que des professionnels de la santé, dont Cécile Rousseau, pédopsychiatre et professeure en psychiatrie sociale et transculturelle à l’Université McGill, aient, dès les débuts de la pandémie, recommandé une consommation modérée d’informations au public québécois.
« Dénoncer le coquin »
Dans la foulée de ces critiques, il ne faut évidemment pas évacuer le rôle fondamental joué par la presse dans la démocratie, ce « quatrième pouvoir » qui tient en respect les trois autres que sont, aux États-Unis, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
Dans la toute première édition du Devoir, publiée en 1910, Henri Bourassa parlait de la nécessité de « dénoncer le coquin », qui n’a certainement pas disparu aujourd’hui. Pour Patrick White, c’est entre autres pour ces raisons que le « journalisme de solutions » est l’une des avenues que doit emprunter le journalisme d’aujourd’hui, mais pas la seule. « Le journalisme d’enquête est aussi très valorisé », mentionne-t-il, ajoutant que l’intelligence artificielle pourrait bientôt suggérer aux journalistes des anomalies dans les bases de données, au sujet de la pollution ou de la criminalité, par exemple.
SOURCE: LE DEVOIR