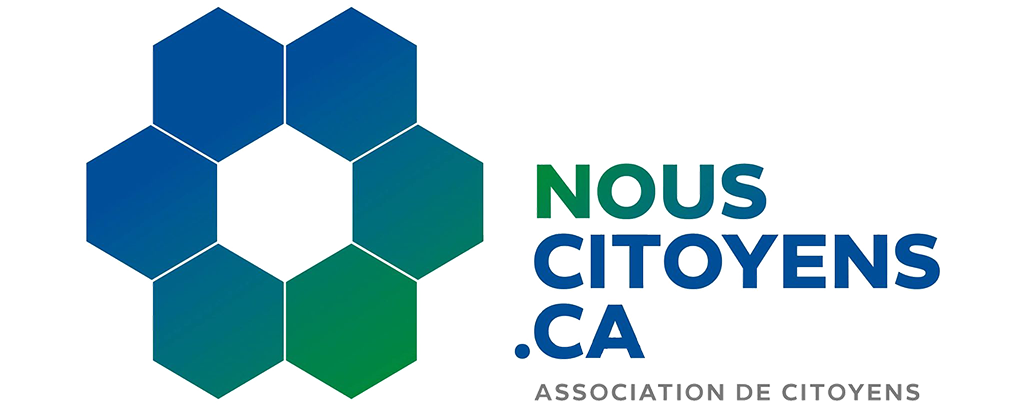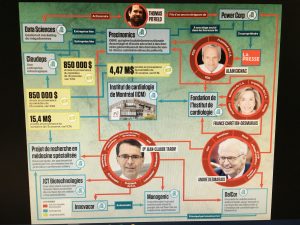INDIGNEZ-VOUS
de Stéphane Hessel
Indigène éditions, 32 p.
INDIGNADOS et
INDIGNADOS/INDIGNEZ-VOUS/EMPÖRT EUCH!/STÉPHANE HESSEL
de Tony Gatlif
France, 2012
QUELLE TERREUR EN NOUS NE VEUT PAS FINIR?
de Frédéric Boyer
P.O.L, 112 p.
L es mots de ce titre, je les emprunte à l’héroïne du roman de Catherine Mavrikakis, Ça va aller. À Sappho-Didon Apostasias, cette dangereuse insurgée, qui crie haut et fort qu’il faut se laisser devenir des « faiseurs de terreur », «exploser la baraque », bousculer toutes nos conventions, pour que quelque chose arrive enfin, que l’insoumission et le chaos détrônent l’apathie et la torpeur. « Parce qu’au Québec, il faut hurler. […] L’avenir du Québec sera turbulent ou ne sera pas. » Lire – ou relire – Ça va aller post-printemps érable 2012, c’est ainsi réentendre l’écho d’un cri d’alarme pressant, un appel à la dissidence qui ne pouvait rester indéfiniment sans réponse. Nous avons fini par vivre les soulèvements quotidiens, la foule, les marches de jour, les manifestations de nuit, le désordre, la brutalité, le paternalisme, la répression. Nous nous sommes convaincus que nous méritions mieux qu’une province sous calmants, amnésique et hésitante. Mais que reste-il de notre indignation, trois ans plus tard ? Avons-nous réussi à créer une petite brèche dans l’histoire, à nous réapproprier la rue une fois pour toutes ? Ou sommes-nous, finalement, trop essoufflés ou résignés pour mener des combats politiques de longue haleine, trop fébriles pour supporter l’instabilité, du haut de notre niveau de vie supérieur et du confort de notre « démocratie acquise » ? Comment demeurer résilients, assumer la force souveraine du « non », lorsque l’urgence d’agir ne tient pas à des questions de vie ou de mort et que les autorités essayent de nous persuader que nous avons tort de nous plaindre, que ça va encore, que ça peut encore aller un tout petit peu plus longtemps ainsi ?
Plusieurs affirmeront que les insurrections qui éclatent un peu partout à travers le monde depuis 2008 proviennent d’un seul et même mouvement, d’une puissance d’agir collective, d’un sentiment d’« Il faut y aller maintenant ». À l’heure où l’hégémonie de la technologie et de la diffusion rapide via les médias sociaux n’a plus à être prouvée, tant elle a modifié l’essence de toute mobilisation de masse, il est difficile de croire que ces révoltes sont complètement isolées les unes des autres, qu’elles sont survenues comme autant de débordements soudains, sans cohérence avec ce qui les précède. Or, d’un lieu à l’autre, d’Athènes à Barcelone, de Montréal à New York, de la place Tahrir à la place Taksim, les contextes de crise et les risques encourus par les populations diffèrent aussi grandement, et si l’idée d’unir les révoltes individuelles dans l’imaginaire insurrectionnel pour en faire un rassemblement global est tentante, portée par un désir louable de rallier nos forces et nos ambitions communes, de renverser des systèmes politiques gangrenés, il faut aussi se méfier des simplifications grandiloquentes et des amalgames.
L’appellation/jeu de mots « Printemps érable », qui visait à établir une certaine parenté, aussi ténue soit-elle, entre la situation québécoise et les révolutions arabes, atteste de cette facilité à gommer les singularités des soulèvements, à les faire entrer rapidement dans le moule généralisant et mythifiant de l’Indignation avec un grand I. Les révoltes n’ont pas à être reprises, « utilisées » à des fins de légitimation, calquées les unes sur les autres lorsque discutées dans l’espace public, car nos états de choc, nos prises d’assaut et nos stratégies revendicatrices sont spécifiques à l’intensité de nos radicalités. Et cette peur au ventre, cette peur nécessaire pour que « cela se réveille », cette peur qu’on souhaite transmettre à ceux qui nous imposent de tels rapports de force, n’a certainement pas la même incidence dans tous les pays. Il est donc nécessaire d’analyser quelques enjeux et problèmes qui résultent du choix de traiter des soulèvements en les « regroupant » au sein d’une œuvre culturelle, de même que la décision de les transformer en un seul et commun agir politique, magnifié et irréductible.
PRUDENTES INDIGNATIONS
En 2010, l’écrivain et militant politique français Stéphane Hessel a fait paraître un opuscule d’une trentaine de pages intitulé Indignez-vous, où il dénonçait la dictature internationale des marchés financiers qui creuse les inégalités sociales et menace les démocraties européennes déjà fragilisées. Hessel, en rappelant l’importance de l’héritage des vétérans des mouvements de la Résistance, exhortait les jeunes générations à se rebeller contre la pensée productiviste, à considérer leurs motifs d’indignation comme des dons précieux et essentiels à une société en santé, et pas : «cette société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l’égard des immigrés, pas cette société où l’on remet en cause les retraites, les acquis de la Sécurité sociale… » L’essai de l’ancien résistant de 93 ans a fait l’objet d’un engouement littéraire hors du commun, le livre se vendant à plus de quatre millions d’exemplaires en moins d’un an.
Le cinéaste Tony Gatlif, que l’on connaît pour ses films engagés (Mondo, Gadjo Dilo, Exils) et son appui indéfectible aux peuples roms, gitans et tziganes, a été particulièrement touché par les mots d’Hessel et a décidé de s’en inspirer pour réaliser deux œuvres qui visent à donner un nouveau souffle au texte : le premier, Indignados, s’apparente plutôt au sous-genre du docu-fiction, et le second, Indignados/Indignez-vous/Empört Euch !/Stéphane Hessel, à « un manifeste en images », produit et diffusé par la chaîne ARTE France.
Bien que tournés la même année, les deux documentaires abordent l’opuscule d’Hessel différemment, le premier privilégiant les métaphores visuelles et une construction narrative lyrique et éclatée, tandis que le second alterne plutôt entre des captations prises lors de soulèvements – des « Indignados » d’Espagne aux « We are the 99% » du mouvement Occupy – et des extraits d’entrevues avec Hessel. Or, si les deux projets de Gatlif portent en eux l’âme d’une certaine révolte, appuyée chaque fois par une bande sonore puissante où la musique klezmer devient presque un personnage, tant son impact sur la mise en récit est réel, la parole contestataire, argumentative, elle, ne semble jamais s’élever assez haut, se faire assez détonante. On peut ainsi se demander pourquoi le propos d’un documentaire comme Indignados, qui défend le droit à la désobéissance des laissés-pour-compte, toutes sociétés confondues, s’avère aussi peu enlevant. Les deux films de Gatlif, en effet, dénoncent, « s’indignent » à travers leur traitement, parfois très poétisé – qu’on pense à une scène du docufiction où des tracts aux couleurs de l’Espagne virevoltent au-dessus d’une danseuse de flamenco en spectacle, ou aux effets de montage parallèle de la production d’ARTE, où Gatlif filme en alternance le défilement continu des chiffres de la Bourse et les jambes des manifestants qui avancent –, mais jamais la colère n’est mise à l’avant-plan de la réalisation, jamais l’incitation à la sédition dans l’écriture cinématographique ne se fait concrètement sentir. Comment s’expliquer cette impression de tiédeur, de « cri trop poli », alors que les levées populaires sont multiples, exposées ici les unes par rapport aux autres selon une logique d’ensemble ? Est-ce la voix de Gatlif qui fait défaut, entérinant sans regard critique le manifeste d’Hessel et édifiant du même coup l’homme comme LE grand maître à penser de la résistance ? Ou n’est-ce pas plutôt les propositions d’Hessel elles-mêmes, qui, au final, manquent de véhémence et de rigueur politique ?
DE LA CRÉATION AU « DEVENIR-HYDRE »
Un livre dit « de révolte » qui devient au bout de quelques mois un phénomène d’édition, un produit de consommation au même titre que n’importe quel best-seller vendu à rabais à la FNAC, peut éveiller certains doutes. Pas parce que les idées qui y sont défendues sont nécessairement fausses ou naïves – au contraire, il ne servirait à rien de s’opposer viscéralement aux principes pacifistes et aux mots bien pesés d’Hessel –, mais plutôt parce que le succès littéraire incite souvent au consensus général, et ce consensus, plus dangereux qu’il n’y paraît, neutralise l’esprit critique du lecteur, comme celui du manifestant. Les gens, souvent, prennent position grâce à des discours simples, accrocheurs. Des mots forts et accessibles, qui semblent dire « vrai ». Des phrases bien tournées, inspirantes, dignes de figurer sur un sac de toile noire RenaudBray. « Soyons réalistes, exigeons l’impossible ». « Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable ». La formule « Créer c’est résister, résister c’est créer » d’Hessel, que les indignés européens ont adoptée en grand nombre (tags sur les murs, pancartes, cris durant les manifestations), pourrait se classer dans cette catégorie de phrases-slogans, où la tautologie flirte d’un peu trop près avec l’envie de « parler grand ». Mais cette fameuse création tant prisée, derrière quels mots et quels gestes se cache-t-elle ? Peut-être faudrait-il justement lui permettre de naître à même les nouveaux « parlers » révolutionnaires. Peut-être devrions nous écouter les voix un peu plus discordantes, un peu plus rauques, celles qui sortent des sentiers battus, qui osent retourner les révoltes sous tous leurs angles sans les glorifier, celles qui ne les abordent pas comme des entités immuables. À quoi auraient ressemblé les soulèvements des dernières années si, par exemple, quatre millions d’humains avaient appris par cœur des phrases de L’insurrection à venir du Comité invisible plutôt que le manifeste d’Hessel ? Qu’arriverait-il si tous les insurgés se mettaient à légitimer une parole à la fois plus impérieuse et plus pragmatique, qui ne suppose pas seulement que « le socle des conquêtes sociales de la Résistance est remis en cause » (Hessel), mais qui affirme sans compromis que « ce n’est pas le monde qui est perdu, c’est nous qui avons perdu le monde […] La crise n’est pas économique, écologique ou politique, la crise est avant tout celle de la présence. » (À nos amis, Comité invisible) ?
Les deux documentaires de Gatlif soulèvent aussi (et peut-être à leur insu) l’un des grands problèmes de la représentation des rébellions contemporaines : celui de ce passage inévitable du « je » au « nous » au cœur des argumentaires. J’ai moi-même commencé cet article en parlant d’un « nous » québécois, pour dériver vers un «nous » à échelle plus vaste. Mais là où le bât blesse, c’est bien dans cette idée de penser « l’ensemble qui lutte » à partir de la voix d’un seul homme, de placer un résistant au-dessus de la foule, aussi « sage » soit-il. Comme l’avoue un manifestant égyptien dans À nos amis : « Je crois que ce qui aura sauvé ce qui se passe en Égypte jusqu’à maintenant, c’est qu’il n’y a pas de leader de cette révolution. C’est cela peut-être la chose la plus désarçonnante pour la police, pour l’État, pour le gouvernement. Il n’y a aucune tête à couper pour que cette chose s’arrête. » Ainsi, le « nous » le plus fort sera sans doute celui qui réussira à se faire « hydre », à assurer sa propre régénérescence grâce à un pouvoir d’imagination et d’organisation qui déjouera l’Histoire en prouvant que nulle mémoire n’est fixe, mais plutôt, comme le dit Frédéric Boyer dans son plus récent essai Quelle terreur en nous ne veut pas finir ?, que c’est « une construction, un muscle, une création, avec des passages, des erreurs, des lapsus, des condensations, des contaminations, des répétitions, des retournements, des réanimations… »
ENTRE NOUS, CONTRE NOUS
Paru en mars dernier, Quelle terreur en nous ne veut pas finir ? rejoint certains idéaux humanistes du manifeste d’Hessel, tant par l’importance que Boyer accorde à la reconnaissance de « l’autre moins nanti » que dans sa façon d’aborder les thèmes de la tolérance et du danger de l’indifférence mutuelle. Cela dit, si l’auteur de Phèdre les oiseaux prend lui aussi le pari de parler au « nous », d’analyser la société (française, plus spécifiquement) dans ce qui la fonde ou la divise, la réflexion sur « l’ensemble » se révèle ici plus fine et concluante que chez Hessel ou Gatlif, dans la mesure où Boyer, même s’il adopte une perspective très large en questionnant le « poids de notre unité » et la responsabilité de se savoir humain au milieu des autres, aborde de front les problèmes du vivre ensemble et de la dénégation civique qui, somme toute, ont de nombreuses conséquences sur l’avenir des insurrections.
Comment, en effet, militer au nom de toutes les minorités, alors que « nos identités sont closes » et que la vraie rencontre avec l’Autre est souvent illusoire ou momentanée ? Comment gagner des luttes lorsque l’unité entre les communautés d’une même ville demeure fragile ? D’où, encore une fois, l’importance de rester attentifs aux amalgames et à cette tentation du « rassemblement » qui rallierait harmonieusement toutes les classes de la société. Car s’il y a certainement soutien et solidarité des indignés envers les communautés opprimées et abandonnées des
gouvernements, qu’il soit question des Roms en Europe ou des Autochtones au Québec, les contextes et les moyens de lutte et de survie divergent grandement. L’essai de Boyer, qui pourrait être qualifié de pamphlet pour son souffle et sa charge contestataire, est d’ailleurs sans équivoque en ce qui concerne le sort des « sans maison », des « sans terre » : « [J’]observe que ce sont eux que nous perdons, que nous laissons couler, que nous laissons se noyer, tandis que nous crions à notre propre agonie, que nous hurlons à notre propre destruction et au remplacement de nous-mêmes ».
Le « nous » qu’emploie Boyer ici ne représente pas le « nous » des insurgés, mais bien un « nous » plus global, celui du peuple citoyen en proie à une peur qu’il préfère garder dans l’ombre : la peur de l’étranger. Avec beaucoup d’aplomb, Boyer parvient à décrire précisément comment les sociétés vivent dans l’effroi de leur propre mémoire vivante, dans le refus inconscient de participer à la vie des autres, s’imaginant toujours sous la menace d’une éventuelle disparition provoquée par ces « nouveaux inconnus ». Car s’il y a bien, chez certains, une peur positive, grisante,
violente, qui va de pair avec l’exorde de toute rébellion, il y a aussi, chez d’autres, cette terreur passive, enfouie, répressive pour la contrecarrer. Mais nulle crainte, pourtant, du langage dans l’essai de Frédéric Boyer. L’écrivain français, avec ce livre, réussit à donner de nouveaux sens à des mots fortement connotés, tels l’honneur, l’éthique, et plus particulièrement la morale, mot au cœur de Quelle terreur… qu’il détourne habilement des concepts de jugement et de bienséance pour le considérer plutôt comme une arme de sédition : « La morale qui exige que nous nous mettions en péril aux moments précis de notre peur diffuse. […] Cette force de résistance à nous-mêmes, finalement, et à ce que le monde fait de nous. »
« Résister à nous-mêmes », tel serait peut-être dès lors le nouveau défi à relever. Refuser notre défaitisme, notre méfiance, nos raccourcis de pensée. Ignorer les paroles révolutionnaires convenues ou déjà éteintes. Puis continuer de lire ceux et celles qui ébranlent la langue, qui la désamorcent pour mieux la recréer, qui la rendent un peu plus « hydre », insoumise, mais surtout un peu plus terrifiante.