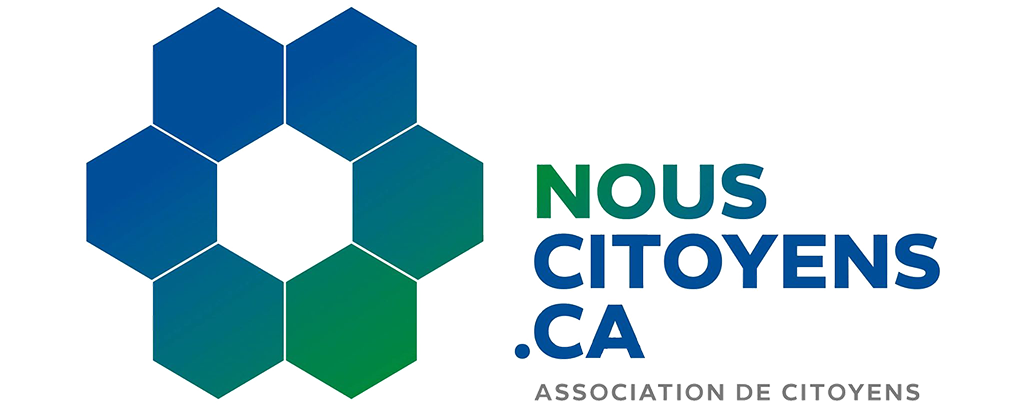ANNE-EMMANUELLE LEJEUNEENSEIGNANTE ET FÉMINISTE UNIVERSALISTE
L’enseignant a le devoir d’obéir de son propre chef pour que l’ère de la démocratie critique existe
Il y a quelques jours, j’ai reçu un courriel d’une amie dans lequel elle me demandait un service. Elle l’a terminé avec un « merci pour ta collaboration ». Mon amie n’est ni en éducation ni en politique. Son choix de mots m’a fait réfléchir sur la banalisation du mot « collaboration ».
Que se cache-t-il derrière ce mot ? Comment une société qui use du mot « collaboration » peut-elle être à ce point réticente face à la possibilité du débat estimé à tort comme un conflit ?
Ma réflexion touchera l’école et la politique, les deux étant désormais plus que jamais liées.
J’ai lu récemment sur Facebook le délicieux témoignage d’un médecin racontant son expérience d’instituteur pendant une heure qui illustrait parfaitement la complexité et la difficulté de la tâche des enseignants, mais sa conclusion m’a fait bondir.
Il a cru bon de préciser qu’il était évident qu’ils ne faisaient pas ce travail pour l’argent comme s’ils étaient tous en couple avec un médecin, comme s’ils avaient choisi leur profession pour ne pas avoir besoin d’en vivre, comme si leur travail devrait, à l’idéal, rester une coopération avec la société.
La collaboration est l’action de collaborer avec une ou plusieurs personnes. Elle est aussi le fait, pour les habitants d’un pays occupé, de collaborer avec l’ennemi.
Le mot « collaboration » est teinté d’une lourde charge sémantique de l’autre côté de l’Atlantique.
L’historien Johann Chapoutot a récemment publié Libres d’obéir : Le management, du nazisme à la RFA : il y souligne une constance entre les méthodes d’organisation du régime nazi et celles que l’on retrouve aujourd’hui au sein de l’entreprise, et donc, de l’école évaluée et gérée par la gestion par résultats (GPR) telle une entreprise.
Pour produire massivement, les nazis ont motivé le « matériau humain » par une conception du travail non autoritaire pour que le travailleur accepte son sort avec liberté et autonomie dans la « joie ». Le langage joue ici un rôle capital : Victor Klemperer a constaté un avilissement de la langue commune par la phraséologie nazie à l’œuvre de la manipulation des masses. Voilà qui nous rappelle George Orwell et sa novlangue, dont le but est l’anéantissement de la pensée, la destruction de l’individu, l’asservissement du peuple. L’argumentation devient idéologique et l’usage des mots, malhonnête.
Autrement dit, confondre collaboration avec coopération est un abus de langage, une volonté de contrôle afin d’imposer une soumission volontaire au nom de la responsabilisation par moult réunions de concertation en vue d’uniformiser les pratiques et donc, la pensée. Le choix du mot « collaboration » n’est pas anodin, puisque coopérer, c’est travailler ensemble librement sans liens hiérarchiques.
Gouverner, c’est rassembler, et non ostraciser. Gouverner, c’est aussi causer, prévoir et savoir. Or, au Québec, tout est fait pour que l’on ne sache pas, pourvu que l’on compte des sous.
Son gouvernement est devenu un champion de l’extinction des contre-pouvoirs, un suiveur d’opinions sur Facebook, un expert en sophismes (le meilleur étant celui des profs en congé pendant les journées pédagogiques), et en généralisations abusives lorsqu’il dit avoir l’appui de tous les Québécois (c’est-à-dire 24,4 % des électeurs inscrits qui ont voté pour la CAQ en 2018, selon Steve E. Fortin) qu’il fait parler en sa faveur en utilisant une communication tyrannique et manipulatrice. Il oublie l’électorat qui n’a pas voté pour lui. Il oppose les électeurs insidieusement au lieu de les rassembler autour d’un débat démocratique qui aurait fait de lui un bâtisseur d’avenir pour tous.
« Il est plus facile de duper les gens que de les convaincre qu’ils ont été dupés », a écrit Mark Twain. Recourir à une procédure antidémocratique pour forcer un projet de loi qui abolit la démocratie, il l’a fait de façon surréaliste lors du vote du projet de loi 40. Vanter la collaboration avec les enseignants dans son projet de loi, il l’a fait aussi, mais dans les faits, nul n’en connaît le modus operandi.
Les 22 000 réfractaires, selon une pétition lancée en ligne le 31 janvier, se verront accuser de manquer de flexibilité et de souplesse, comme si le changement pour le changement était un signe de force et de dynamisme. Le philosophe Pierre Ansay va jusqu’à dire que cette manière de faire du nouveau à chaque instant, de mener l’action politique comme un consultant qui reconfigure à tour de bras érode la confiance entre le militant, le citoyen et les décideurs publics.
Il y a quelque chose de plus pernicieux dans cette imposture langagière : c’est la censure qui n’est jamais pire que lorsqu’elle devient de l’autocensure.
Face à cette domination et à cette direction de choix de mots, nous avons un devoir de résistance et de désobéissance.
Je crois que les enseignants ont assez souffert et que leur confiance est suffisamment érodée pour résister à cette violence institutionnalisée et au gouvernement qui exige qu’ils soient de simples exécutants, tout en collaborant à combler la pénurie pour un salaire dont la croissance est inférieure à l’inflation.
L’enseignant est le représentant de l’humanité, de la culture et de l’esprit critique. Il a le devoir d’obéir de son propre chef pour que l’ère de la démocratie critique existe. Pour y arriver, un seul moyen : le refus collectif… en toute coopération !
« La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes ; parce que, pour elle se soumettre, ce serait cesser d’exister. » (Henri Poincaré)